Il est sans nul doute l’un des plus talentueux représentants contemporains de la littérature en langue espagnole. Dans cette interview, Leonardo Padura nous parle de Poussière dans le vent, son dernier roman qui relate l’histoire d’un groupe d’amis qui se surnomment El Clan. La plupart d’entre-eux ont suivi le douloureux chemin de l’exil. Padura est quant à lui resté à Cuba, se donnant à corps et âme à l’écriture et faisant ainsi de son œuvre un précieux témoignage de l’histoire récente de de son pays.
Poussière dans le vent débute avec deux jeunes qui se rencontrent, Adela et Marcos. Adela est née à New-York, mais a des origines cubaines. Quant à Marcos, il est cubain et s’est récemment installé à Miami. Ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre et se mettent en couple rapidement. Mais un jour, une photo surgie du passé change à jamais leurs vies. Le passé revient toujours… Peut-on y échapper ?
Je crois que non. Le passé, arrive toujours à te rattraper. En réalité, nous sommes le résultat de choses qui se sont produites au cours d’une vie. Le futur est imprédictible et, dans ce sens, il en va de même pour le poids du passé dans la vie d’une personne. Adela, ne connaissait pas son passé. Quant à Marcos, il ne savait pas qu’avec leur rencontre, il devrait affronter le sien. Et le roman est le développement de cet élément dramatique. C’est ce qu’on appelle au cinéma le tournant de l’histoire.
L’un des grands points forts du roman est la façon dont vous entrelacez les différents chapitres. Vous passez tout naturellement du présent au passé et vice-versa…
Oui, pour moi ça a été un exercice difficile. Pendant l’écriture, j’ai dû avoir tous mes sens en alerte pour ne perdre pas de vue à quel moment de l’histoire je me trouvais, ce que j’avais déjà dit, ce que je devais encore dire et ce que je ne pouvais pas encore dire… et surtout ce qui arrivait à chacun des personnages.
C’est un roman polyphonique et la construction de chaque personnage m’a demandé une énorme attention. Et puis, il faut assembler cette structure. Je mets des briques pour élever un mur et aussitôt, je me tourne vers un autre mur, puis encore un autre et c’est comme ça que j’ai fini par élever les quatre murs du roman qui, au début, ne sont pas nécessairement au même niveau, mais au final composent un tout harmonieux.
Une grande partie du roman se déroule lors de la Période spéciale, époque pendant laquelle une crise économique sans précédent frappe le pays suite à l’effondrement de l’URSS et l’embargo américain. C’était une évidence pour vous ?
La Période spéciale est un moment clé dans l’histoire de la Cuba contemporaine. À partir de là, Cuba change profondément, de même que le peuple cubain. C’est un tournant dans le destin de ma génération et du pays tout entier. On peut dire que nous sommes arrivés à un point de maturité. Nous avons fait des études universitaires, nous étions maintenant des professionnels et nous souhaitions obtenir les fruits de nos efforts, mais d’un coup, tout s’est effondré.
Avec cet effondrement, notre capacité de résistance a pris un coup. Pendant des années, nous avons résisté à beaucoup des choses, mais là, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et c’est ainsi que commencent la diaspora et l’exil. Une diaspora et un exil qui continuent encore avec des Cubains partout dans le monde, même dans les lieux les plus insoupçonnés.
Cette rupture historique est propice à la littérature, ce fut une période très dramatique et ce qui est dramatique est par essence très littéraire.
Poussière dans le vent est une histoire sur de multiples exils. Il y a des exilés qui choisissent de partir à l’étranger, Madrid, Barcelone, Miami, Buenos Aires, Toulouse… mais il y a également ceux qui restent à Cuba et qui, en se retrouvant loin de leur famille, de leurs amis, vivent en exil dans leur propre pays…
Je ne sais pas jusqu’à quel point c’est possible, mais je pense que « los insilios » (NDLR : les exilés de l’intérieur) existent. La preuve, on la retrouve dans cette période de pandémie. Dans de nombreux endroits du monde, nous avons vécu en « insiliados ». Pour ma part, dans cette période de confinement, le plus difficile a été l’impossibilité d’entretenir des relations normales avec les personnes de mon entourage ou avec mes amis. Le fait de ne pas pouvoir voyager ou de devoir rentrer chez moi à neuf heures du soir était aussi extrêmement difficile à supporter.
Par exemple, dans le cas de Clara et Bernando, ils s’extirpent de cette situation en restant ensemble à Cuba. Leur relation amoureuse est salvatrice pour eux deux, c’est sans doute pour cela que la fin du roman est si énigmatique. Que va-t-il se passer pour Clara lorsqu’elle rentrera à la maison et ressentira cette solitude angoissante ? D’une certaine façon, c’est aussi une question que je me pose à moi-même car j’ai une peur noire de la solitude…
En général, les exilés quittent leur pays avec l’idée de recommencer quelque part une vie meilleure, même en repartant de zéro. Mais dans votre roman, on perçoit bien la douleur de ce que l’on a laissé derrière soi, le profond sentiment de déracinement…
On ne repart jamais vraiment de zéro. On a toujours un passé, mais on arrive dans un contexte social très différent, tant à un niveau culturel que parfois même linguistique.
De toute façon, cette question est complexe. C’est terrible, l’histoire de ce Cubain qui part chercher une vie meilleure mais sans nul doute, c’est bien moins pire que l’histoire du subsaharien qui parcourt la moitié de l’Afrique pour arriver en Europe, non pour trouver une vie meilleure, mais tout simplement pour vivre… Ils fuient des tueries, des guerres civiles, des famines, des maladies…
De notre point de vue, cela peut sembler dramatique que des Cubains quittent leur pays pour s’installer à Miami, en Espagne ou en France et souffrent de déracinement. Mais dans leur exil, il y a une quête de bonheur. Milan Kundera disait dans L’insoutenable légèreté de l’être, « Celui qui veut quitter le lieu où il vit n’est pas heureux. » C’est un livre dont j’ai fait mention dans mon roman. Les Cubains de mon livre s’en vont surtout pour trouver cet espace de bonheur qui leur faisait défaut à Cuba.
Le roman est également l’histoire d’une grande amitié entre plusieurs personnes, les membres d’El Clan, une amitié qui perdure et se renforce en dépit de la distance et du temps qui passe…
C’était l’un de mes objectifs, dévoiler la valeur et le besoin de l’amitié. Le roman parle de ces complicités qui se sont installées dans un moment particulier de notre vie et qui, plus tard, sont très difficile à recréer. Nous avons grandi ensemble et nous connaissons nos familles respectives, ça change tout. Ce sont les amis qui nous ont marqué, grâce à eux, nous sommes devenus ce que nous sommes. C’est dans ce sens-là que je conçois l’amitié des personnages d’El Clan.
Cette conception de l’amitié est pour moi très importante. Par ailleurs, l’amitié est toujours très présente dans mes livres comme par exemple dans l’univers de mon personnage Mario Conde ou dans le roman Le Palmier et l’Étoile.
Vous avez construit une magnifique galerie de personnages, incroyablement humains, avec leurs qualités et leurs travers, pleins de clairs-obscurs. Comment sont-ils sortis de votre imagination ?
Avec beaucoup de travail. D’abord, j’ai commencé à développer un éventail des personnages, chacun avec ses aptitudes et ses traits de caractère. Il fallait créer des personnages issus des différentes couches sociales, avec des métiers différents, mais tous unis par un profond lien d’amitié. Puis, j’ai commencé à mettre plus de chair et de sang dans ces caractères au point que quelques- uns m’ont surpris, avec des aptitudes et des comportements que je n’avais jamais imaginé qu’ils auraient au départ. Ils deviennent indépendants et finissent par te demander certaines choses. Ça, c’est la partie la plus extraordinaire du métier d’écrivain.
J’essaie toujours de doter mes personnages d’une humanité la plus complète possible, avec toutes ses contradictions.
Vous évoquez dans le roman les livres 1984 et L’insoutenable légèreté de l’être…
Ce sont deux livres qui ont un rapport certain avec l’histoire de mon propre roman et de la société cubaine en général. Il s’agit des livres sur des sociétés sous contrôle où la censure règne. Ces références ne sont pas innocentes. Elles ont une signification et complètent la perspective et l’intention du récit. Les personnages du roman vivent dans une société qui pourrait très bien être celle de 1984 ou de L’insoutenable légèreté de l’être.
Lors de votre discours dans le cadre de la remise du Prix Princesse des Asturies de littérature pour l’ensemble de votre œuvre, vous avez déclaré avoir trois patries, Cuba, la langue et le travail. À propos de la langue, qu’est-ce que cela signifie pour vous d’écrire et de vous exprimer dans une langue qui concerne environ 500 millions des personnes ?
C’est un privilège d’avoir comme outil une langue comme l’espagnol, pas seulement pour le grand nombre des personnes qui la parlent, mais aussi pour la quantité phénoménale de personnes qui l’ont écrite. Les mots sont les seuls outils dont nous, les écrivains, disposons pour nous exprimer. La langue castillane est tellement riche, fourmille de tant de possibilités expressives que je ne pourrai jamais en avoir une maîtrise parfaite.
Un dernier point, nous, les auteurs en langue espagnole, nous pouvons communiquer avec une très grande quantité de lecteurs dans notre langue d’origine. Malheureusement, le rapport à la lecture dans le monde hispanique n’est pas la même que dans le monde anglo-saxon ou germanique pour différentes raisons, mais ça, c’est une autre histoire…
La langue n’est pas seulement un outil d’expression d’idées, c’est une manifestation de la culture et j’écris personnellement dans un espagnol cubain. Parfois, je réalise qu’il y a tellement de possibilités d’expression en langue cubaine de sentiments, de situations et d’idées que je complique sans le vouloir la tâche de mes traducteurs.
Que vous a apporté le personnage de Mario Conde ?
Mario Conde a été une chance inouïe. Je n’avais jamais pensé qu’il ferait une telle carrière ! C’est un personnage que j’ai créé pour un roman policier. Il fallait qu’il soit différent de tous les autres personnages de romans policiers cubains. Petit à petit, le personnage m’a permis de dresser le portrait de la société cubaine. Je dis toujours que Mario Conde, c’est mes yeux, il chronique pour moi la vie cubaine d’aujourd’hui.
De plus, je l’ai fait vieillir avec moi. Il me permet ainsi de réfléchir sur le temps qui passe et sur le poids du passé. Au final, il me permet de comprendre aussi bien une réalité extérieure qu’une réalité intérieure.
Pour quand votre prochain roman ?
Je suis en train d’en finir la première version. J’ai profité du confinement pour l’écrire. En ce moment, plusieurs personnes sont en train de le lire…Je pense qu’il sera prêt pour l’année prochaine. C’est une histoire où l’on retrouve le personnage de Mario Conde et qui se déroule dans deux temporalités historiques différentes. La première en 2016, autour de la visite d’Obama à Cuba, la seconde en 1910 avec pour cadre une rixe entre proxénètes cubains et français à La Havane qui a eu véritablement lieu.
Le titre sera La isla y el delirio. Je souhaite qu’il soit le roman le plus policier de tout ce que j’ai pu écrire jusqu’à présent. On verra une fois achevé, mais pour l’instant, il y a beaucoup plus de morts dans celui-ci que dans tous mes autres romans (rires).
Crédits Photos : Iván Giménez
Retrouvez ici notre chronique de Poussière dans le vent.
INFOS ÉDITEUR
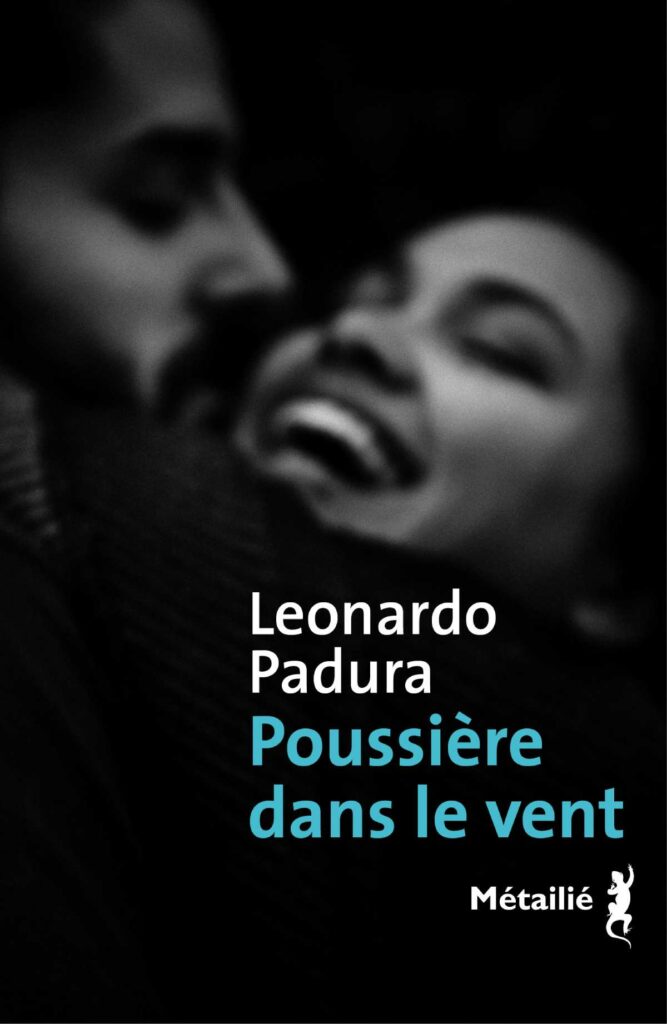
- Titre original : Como polvo en el viento
- Langue originale : Espagnol (Cuba)
- Traduit par : René Solis
- Publication : septembre 2021
- Éditeur : Métailié
- Pages : 640






